9 décembre 2021#28
L’école, c’est fini ?
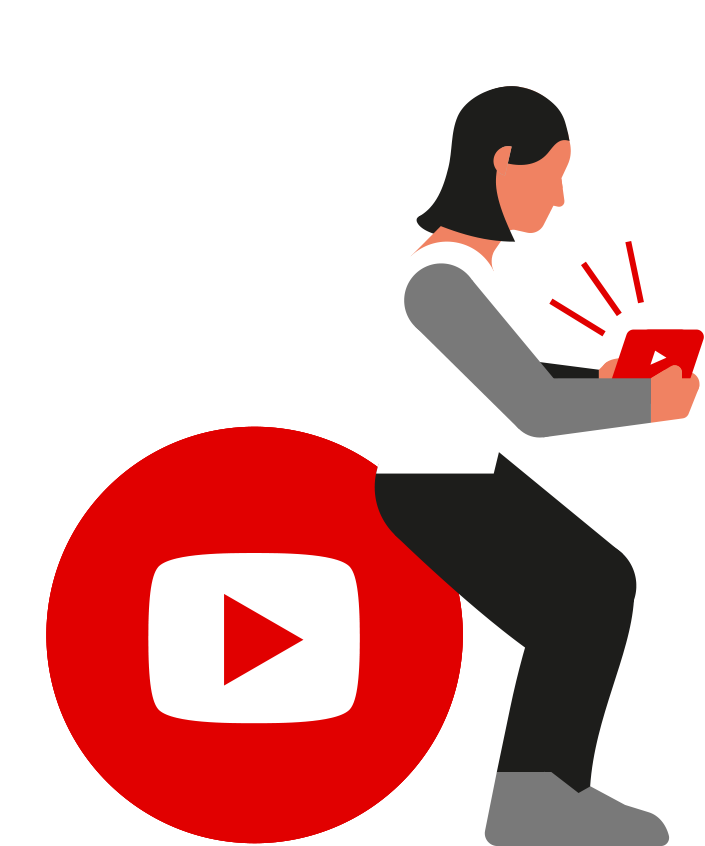


Vous vous en souvenez : après le confinement, on a tout fait pour que les étudiants reviennent le plus vite possible dans les amphis et que les cours reprennent exactement comme avant. Et si on avait complètement fait fausse route ? Parents, enseignants, étudiants, attention ! L’AntiÉditorial vous présente une thèse un peu iconoclaste !
L’école est finie !
Faut-il abandonner la salle de classe ? Ce n’est pas un cancre qui le propose, mais un très sérieux média britannique, The Guardian, qui compte pourtant beaucoup d’enseignants parmi ses lecteurs et lectrices. « La pandémie a fait faire un grand bond en avant à l’apprentissage numérique. Quel est l’intérêt de regarder en arrière ? » Celle qui pose la question, c’est Laura Spinney. Une journaliste scientifique qui s’est intéressée notamment à la grippe espagnole de 1918. Les pandémies, on le sait, changent le monde.
Laura Spinney le rappelle : le Covid « a donné un énorme coup d’accélérateur à l’apprentissage virtuel. Du jour au lendemain, écoles et universités ont fermé leurs portes et les enseignants et étudiants ont dû trouver des moyens de faire ce qu’ils font exclusivement via internet. » Certains ont été paumés, bien sûr. D’autres ont éprouvé une terrible solitude, c’est certain. Oui mais, pour autant, les étudiants ont-ils appris moins bien ?
Pour la professeure Diana Laurillard, du Knowledge Lab, le laboratoire de la connaissance d’University College à Londres, « il n’est pas possible de revenir à la situation antérieure ». En anglais, « the cat is out of the bag ». En français, disons que le fleuve est sorti de son lit. Ou le diable de sa boîte, si vous préférez !
Prenons un cas étonnant : le speed watching. Certains étudiants ont pris l’habitude de regarder cours et conférences en vitesse accélérée. Un peu comme leurs parents ou leurs grands-parents lisaient les livres, disons… en diagonale. Après le Covid, revenus en classe, donc à la vitesse d’écoute normale, celle du prof qui parle, ils s’ennuient. Or des psychologues américains ont mené une étude sur ce sujet dès 2018. Ils assurent que le speed watching n’aurait pas d’impact négatif sur la compréhension…
La classe, c’est le monde
Alors, les plus enthousiastes s’emballent déjà. Le professeur Yong Zhao, didacticien à l’université du Kansas, en est persuadé : « C’est le moment d’imaginer l’éducation sans école ni salle de classe. » Avec une consœur d’Australie, Jim Watterston, il a publié ses thèses sur l’éducation post-Covid dans une revue spécialisée. L’AntiÉditorial les a lues, traduites et résumées. Il y a trois idées :
1/ Les élèves doivent avoir plus de contrôle sur leur apprentissage. Du coup, le métier d’enseignant change complètement. Le prof devient « conservateur des ressources d’apprentissage », conseiller et « motivateur », pour ne pas dire coach. C’est, en plus radical, la philosophie de la classe inversée, les cours à la maison, les devoirs en classe.
2/ Le programme des études doit être axé sur la créativité et l’adaptabilité.
3/ « Le lieu d’apprentissage typique était la salle de classe d’une école et le temps d’apprentissage était généralement limité aux cours. » La pandémie a changé la donne. « Les élèves peuvent apprendre des ressources en ligne et des experts partout dans le monde. Ainsi, le lieu d’apprentissage passe de la salle de classe au monde entier. » Au passage, le traditionnel emploi du temps en prend un coup.
C’est « l’apprentissage mixte », ou blended learning, tantôt en présentiel et en classe, tantôt autonome et en ligne.
C’est aussi « l’apprentissage actif » : la compréhension et la mémorisation seraient meilleures lorsque les étudiants apprennent par le biais de discussions et de technologies interactives.

Une start-up se lance
Stephen M. Kosslyn est un ancien professeur de Harvard, spécialiste de psychologie cognitive. Son associé Ben Nelson vient du monde des start-up californiennes. Il est le fondateur de Snapfish, un site de développement et de partage de photos en ligne. Aux États-Unis, tous deux sont les promoteurs de « l’université intentionnelle ». En 2018, ils ont publié un livre, pas traduit en français, Building the Intentional University. Et ils font quatre critiques radicales :
1/ L’enseignement supérieur ne tient pas ses promesses : les étudiants quittent l’établissement sans être préparés ni au travail ni à la vie.
2/ De nombreux étudiants ne se sentent pas concernés par les cours, et d’ailleurs beaucoup n’obtiennent pas de diplôme.
3/ Les étudiants des pays en développement ont du mal à accéder à des universités de qualité.
4/ L’université est trop chère.
Si cette quatrième critique est sans doute plus fondée aux États-Unis qu’en France, les trois autres ne nous sont pas tout à fait inconnues…
Pour Ben Nelson, « ce que nous appelons le secteur de l’éducation est en fait le secteur de la certification. Vous suivez un cours et vous passez un test qui certifie votre capacité à vous souvenir de certaines informations. Puis vous passez à autre chose. Mais lorsque vous prenez le même apprenant et que vous le testez six mois plus tard, il a perdu entre 30 % et 95 % de ses connaissances. » C’est ce que nous appelons le bachotage. Et il faut dire que nous en avons tous fait plus ou moins l’expérience !
À partir de là, Kosslyn et Nelson veulent donner à l’enseignement supérieur de nouvelles missions. Ce qu’il doit permettre aux étudiants, ils le résument, à l’américaine, en quatre compétences.
Deux compétences concernent la façon de raisonner, de réfléchir.
1/ Comment penser de manière critique, évaluer des affirmations, peser des décisions, analyser des problèmes.
2/ Comment penser de manière créative : vous l’avez compris, on est dans le domaine de la « tech », donc la philosophie de la vie, c’est de créer des produits ou des services !
Les deux autres compétences fondamentales concernent les relations humaines interpersonnelles. 1/ Comment communiquer. 2/ Comment interagir. Là encore, à l’américaine, le maître mot est « efficacité ». Il faut apprendre à négocier, à convaincre, à utiliser la médiation, à travailler avec les autres. Ou à résoudre les dilemmes éthiques. Et toujours ef-fi-ca-ce-ment !
Mais Kosslyn et Nelson ne sont pas seulement des théoriciens. Ils sont passés à l’action. Ils ont fondé Minerva, une start-up à but non lucratif qui veut s’adresser à des étudiants du monde entier. L’AntiÉditorial a regardé le programme. Les matières enseignées ne ressemblent pas trop à celle que nous connaissons dans nos universités ou nos grandes écoles, gestion, littérature, droit ou médecine. Parmi les enseignements fondamentaux, on peut choisir, par exemple, « évaluation des preuves », « pensée critique appliquée » ou encore « les intuitions statistiques et leurs applications ». Il ne s’agit pas d’apprendre les probabilités et les statistiques, mais d’apprendre à les utiliser pour en extraire des informations pertinentes.
Minerva se propose aussi d’agir dans le secondaire, pour les lycéens, notamment à travers des outils pédagogiques, la formation des profs ou des programmes d’« apprentissage hybride » qui s’intègrent aux programmes d’études existants et « améliorent l’engagement des étudiants », un peu comme dans la presse en ligne où on essaie de garder l’attention du lecteur.
Minerva a noué un partenariat avec la fondation Charles-Koch. Charles Koch est un milliardaire libertarien controversé depuis son soutien actif au Tea Party, un mouvement populiste qui, il faut bien le dire, a empoisonné les années Obama. La philosophie libertarienne typiquement américaine affleure : l’école est inefficace et trop chère, l’État ne sait pas faire. Mieux vaut laisser la main aux entrepreneurs, aux visionnaires, à la tech. Mais concrètement, de bonnes vielles écoles achètent ces outils en fonction du nombre d’élèves.
La révolution EdTech
Depuis quelques années, le secteur de la « EdTech », l’éducation numérique, est en plein boom. Aux États-Unis, le tutorat, autrement dit l’accompagnement personnalisé des étudiants, est en cours de transformation sous l’effet du EdTech. Et le Covid a accéléré le mouvement, justement parce qu’il a fallu récupérer des étudiants largués, perdus dans la nature, découragés par la pandémie.
En France, l’université catholique de Lille, sous l’impulsion de son président de l’époque, Pierre Giorgini, a misé très tôt sur la révolution de l’apprentissage, anglicismes compris : learning lab, médialab et autres salles de codesign ont accompagné les désormais classiques espaces de coworking… Tout récemment c’est Bayard, l’éditeur de L’AntiÉditorial, qui a racheté Edoki, une jeune entreprise inspirée par la méthode Montessori.
L’école et l’université devront-elles faire leur révolution ? Dans un secteur marqué par de fortes rigidités et pourvoyeur de nombreux emplois, cela peut sembler improbable. Mais toutes les industries et tous les services culturels ont été bouleversés les uns après les autres, à commencer par la musique et par les médias. Il serait étonnant que l’école reste à l’écart de ces changements…


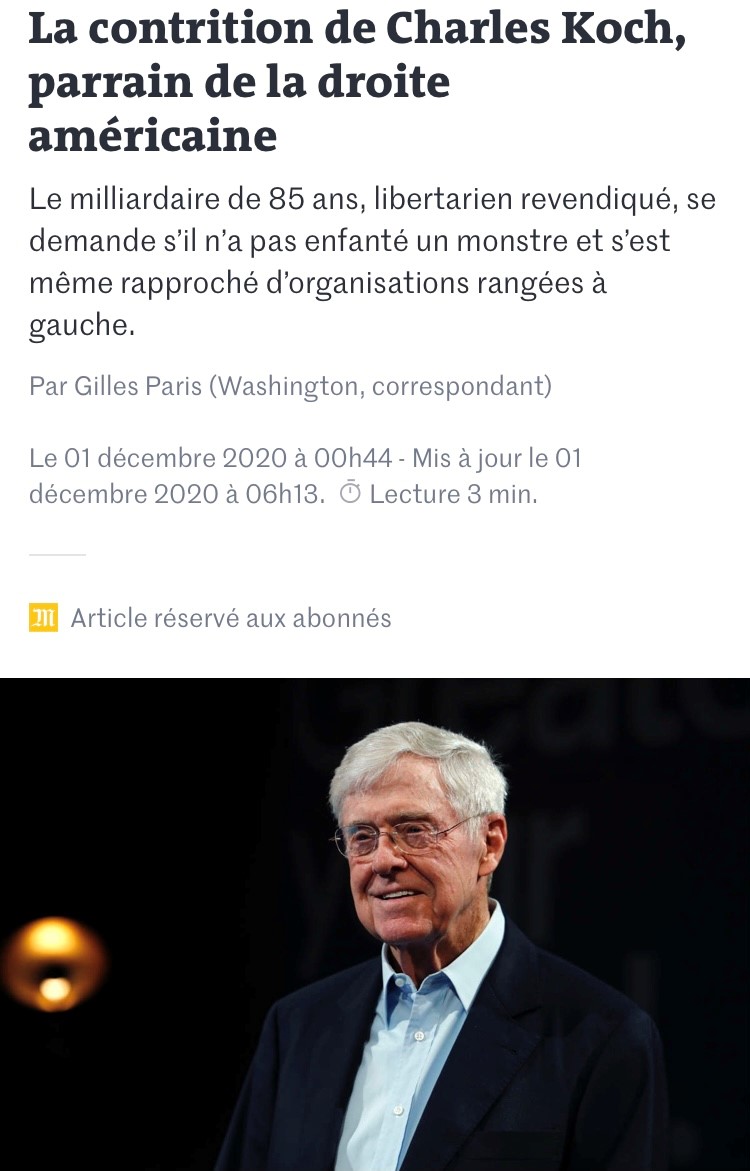
Article publié dans le journal Le Monde. (2020).
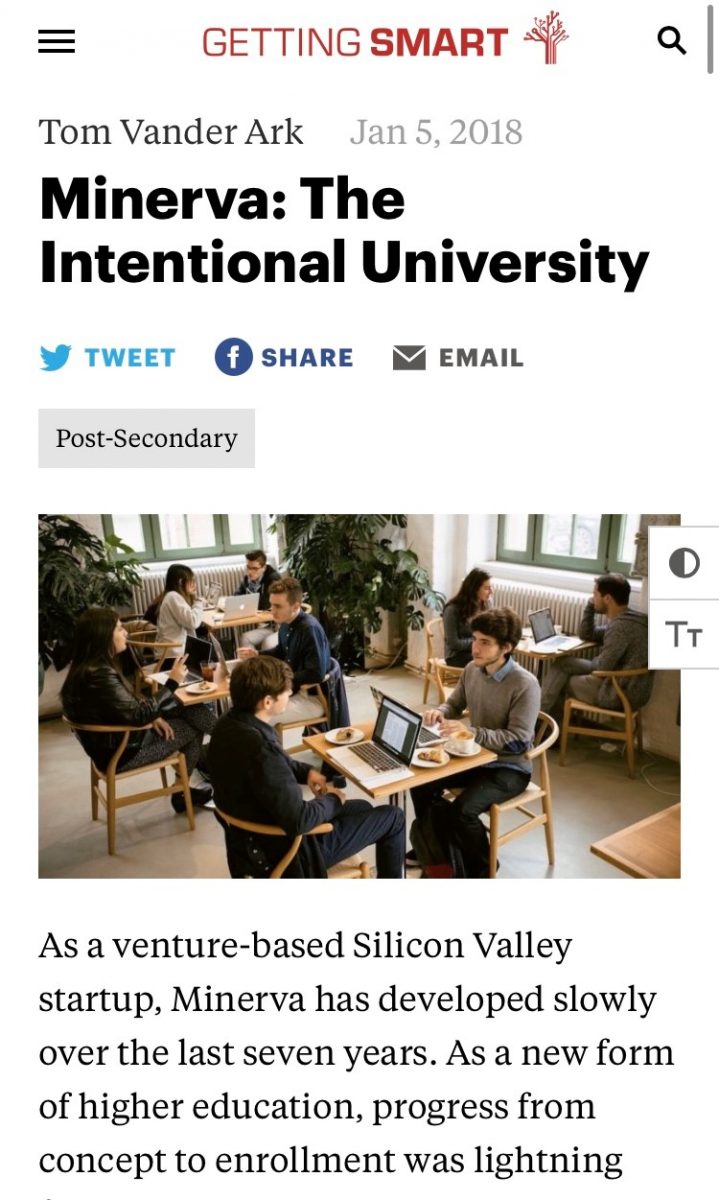
Article publié sur le blog Getting Smart. (2018).

Article publié sur le site L’Étudiant. (2015).




